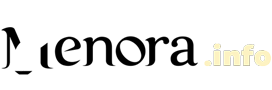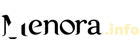Ceux qui s’attachent à décrypter les intentions américaines au Moyen-Orient du point de vue israélien sont partagés entre l’alarme et l’expectative. Conformément à sa volonté de rupture avec l’héritage de Donald Trump, l’administration Biden a délivré dès sa prise de fonctions, une pluie de décisions hautement préoccupantes pour Israël. Les unes tendaient à ressusciter l’option « iranienne » de Barack Obama en multipliant les signes de bonne volonté en direction de Téhéran comme la priorité au retour à l’accord nucléaire de 2015, le retrait des Houthis de la liste des organisations terroristes et une violente charge contre Mohamed Ben Salmane récusé comme interlocuteur politique et personnellement accusé du meurtre de Jamal Khashoggi. Les autres décisions consistaient à « reconstruire la relation avec les dirigeants palestiniens », à restaurer représentation à Washington et aide financière, et à réactiver l’idée de centralité du conflit-israélo-palestinien, relégué au second plan depuis la signature des accords d’Abraham.
Cependant, vis-à-vis d’Israël et à la différence de l’Arabie saoudite, les apparences restaient amicales même si une sourde menace perçait dans une formule laconique du premier texte officiel de l’équipe Biden : « nous ne donnerons pas à nos partenaires du Moyen-Orient un chèque en blanc pour poursuivre des politiques contraires aux intérêts et aux valeurs américains »[1]
En fait, le retour de l’Amérique à l’option iranienne et à l’agenda palestinien déstabilisent profondément Israël. Alors qu’il fait déjà face à ses frontières à la menace des clients surarmés de l’Iran, le Hamas, le Hezbollah, les milices syriennes et irakiennes, la perspective d’une arme nucléaire entre les mains de l’ennemi chiite avec le consentement tacite de Washington se dessine clairement. Questions de survie. Un choc frontal semble alors inévitable entre l’État juif et la nouvelle administration. Mais en miroir, la gravité de la situation met aussi en exergue le rapport de dépendance entre Jérusalem et son puissant allié dans un univers de plus en plus menaçant. Washington lui fournit un bouclier diplomatique, des armes vitales de haute technologie, des pièces détachées et des munitions. Il facilite aussi son accès au marché mondial, aux financements internationaux et aux échanges scientifiques et de technologie, garants de sa prospérité. Comment traiter le dilemme existentiel d’une alliance à la fois délétère et vitale ?
Le plus important est de commencer par comprendre comment fonctionne cet allié si équivoque. Pour discerner les intentions et les contraintes du groupe dirigeant de la Maison Blanche, on doit à Winston Churchill un conseil éclairé : « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. » Les biais dans l’approche américaine des processus de paix qu’ils ont initiés depuis les années 1990 sont extravagants. Leur élucidation permet d’esquisser quelques hypothèses sur ce que voudra probablement faire l’administration Biden au Moyen-Orient et à quels obstacles elle se heurtera.
1 – La rhétorique circulaire des « processeurs »
Shany Mor a proposé dans un essai intitulé Le retour des processeurs de paix,[2] un tableau saisissant de la rhétorique dominante des États-Unis à l’endroit d’Israël pendant trois décennies. C’est un chercheur israélien peu susceptible de promouvoir les analyses de la « droite ». Il s’affirme convaincu, par exemple, que l’évacuation civile et militaire de la Cisjordanie est un passage obligé pour la paix et que les deux mandats de Barack Obama ont été irréprochables sur tous les sujets sauf Israël. Et il salue aussi les « avancées » des administrations précédentes comme le processus d’Oslo ou l’évacuation de la Bande de Gaza.
Shany Mor part du constat que, dans les années 90, le processus d’Oslo a été présenté comme un moyen de réduire la violence des deux cotés. Or, dans la réalité, il a été le point de départ d’une augmentation massive de la violence. Les théoriciens et les initiateurs du processus de paix, les « processeurs » ont alors affirmé qu’ils avaient prévu « un pic de terrorisme dans les premières étapes ». Ou encore, selon un éditorial de New York Times, que la violence était le fait « d’extrémistes qui craignaient que l’autonomie palestinienne ne réussisse. » La violence s’expliquait alors par la réussite en cours des plans des « processeurs » qui avaient pour objectif d’y mettre fin.
Quand la droite est revenue au pouvoir en Israël (en 1996/99), la poursuite de la violence a été imputée à « la frustration des Palestiniens face à un processus de paix désormais au ralenti ». Or les attentats suicide avaient eu lieu dans les trois années précédant l’arrivée de la droite, au moment où, loin de ralentir, Israël était en plein retrait des villes et villages palestiniens en exécution des obligations d’Oslo.
Pourquoi les Palestiniens se sont-ils lancés ensuite dans la violence suicidaire de la 2ème Intifada, renonçant à leurs acquis dont un aérodrome et une multitude de projets ? Les processeurs ne se posent pas cette question. « Il est extrêmement impoli, selon eux, de contester aux Palestiniens la sagesse de leurs décisions. »
Les processeurs sont des médiateurs qui font des propositions censées convenir aux parties en conflit. Or en juillet 2000, Yasser Arafat refusait les propositions de Camp David et lançait sa guerre en septembre. A la suite de quoi il allait recevoir sans que les processeurs ne tiquent, une offre nouvelle en 2001 à Taba (refusée). Son successeur bénéficiera ensuite de l’offre d’Olmert en 2008 puis des pourparlers de Kerry en 2014. A chaque fois l’offre était « meilleure » c’est-à-dire qu’elle était plus favorable à la partie palestinienne et qu’elle s’éloignait de la position israélienne. C’est un paradoxe unique dans l’histoire : « le camp … qui a déclenché une confrontation violente et qui a été vaincu… continue de recevoir des offres toujours plus avantageuses. » Cette façon de combattre la violence et de résoudre des conflits, l’œuvre des « processeurs, » a l’étrange propriété de générer automatiquement de nouvelles violences et de nouveaux conflits puisque violence et conflits paient. Et cette méthode perdante sera validée et reconduite pendant les deux décennies qui ont suivi Oslo.
Du coté des processeurs, l’échec n’a jamais été analysé comme la conséquence du refus palestinien des nombreuses offres qu’ils recevaient. Ils l’imputent à Israël pour trois motifs relevés par Shany Mor :
- L’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995. Il aurait provoqué, selon Martin Indyck, l’arrivée d’un gouvernement de droite opposé à Oslo. C’est faux. Dans l’opinion, la droite avait été non pas renforcée mais affaiblie par cet assassinat et si elle s’est redressée par la suite, c’est à cause de la série d’attentats-suicides de février/mars 1996 et des attaques des hommes d’Arafat en uniforme contre l’armée lors des émeutes des « tunnels » six mois plus tard.
- La dérive vers la droite (Aaron David Miller). S’il est vrai que la droite a progressé et est devenue majoritaire dans l’opinion, ses positions sont devenues « plus et non moins accommodantes sur presque toutes les questions relatives aux Palestiniens. » En 2014, le gouvernement Netanyahou, de droite, s’apprêtait à négocier un statut final sur des propositions plus favorables aux Palestiniens que celles de la gauche.
- Les activités de colonisation. Selon Shany Mor, le nombre d’habitants des colonies qui a doublé depuis 1993 n’est pas le critère le plus pertinent pour décrire ces activités. Il doit être rapproché d’autres données pour prendre sens. Dans la période, le nombre d’implantations n’a quasiment pas changé (120) et la superficie des terres construites est restée entre 1,5 et 2 % du territoire. L’équilibre démographique Juifs/Arabes a été conservé entre 12 et 15% pour les Juifs. Par contre cet équilibre s’est déformé au bénéfice de la minorité arabe en Israël, qui a franchi désormais le seuil des 20%. Un second argument, « les colonies rendent la partition du territoire impossible », ne tient pas non plus car « l’hypothèse [de la partition] pouvait être testée et ne l’a pas été » … du fait du refus palestinien justement. D’ailleurs, les offres israéliennes de 2000/ 2001/ 2008, « prévoyaient d’évacuer la plupart des colonies. »
La affirmation fausse n’est pas le seul procédé pour épargner aux processeurs la confrontation à la réalité. Pour eux, les prévisions démenties par les faits ne donnent jamais matière à réévaluation :
John Kerry affirme en 2014 : « il n’y aura jamais d’accord de normalisation entre Israël et les pays du Golfe » tant que la paix entre israéliens et palestiniens ne sera pas signée. Mais il omet d’expliquer pourquoi les accords d’Abraham de 2020 ont démenti son « jamais. »
Le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem devait provoquer des explosions de violence partout dans le monde musulman. Pourquoi donc ne s’est-il rien passé ?
La rhétorique des processeurs emprunte souvent des chemins de traverse. Cela consiste parfois à refuser tout crédit à ce que disent les Israéliens et les Palestiniens et à énoncer ce qu’il faut réellement entendre.
Par exemple, « s’il n’y a pas de relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes, c’est à cause du traitement infligé aux Palestiniens. » En réalité, comme le disaient les Arabes, « ce refus résultait d’un consensus de longue date car Israël était considéré comme illégitime… et qu’il devait disparaitre. » Ce qui n’a rien à voir avec les supposés traitements condamnables des Palestiniens.
De même quand les Arabes disent « Juifs », il faut entendre « Israéliens » et rien d’autre.
Quand Israël avance des préoccupations de sécurité, il faut comprendre que c’est une pure tactique de négociation.
Quand l’Iran menace de rayer Israël de la carte, ce sont « des fanfaronnades… que seule une personne peu sophistiquée et grossière peut prendre au sérieux. »
Le même travers s’applique aux actes qui doivent prendre le sens qui leur est prescrit par ceux qui ont pensé la paix, indépendamment de leur matérialité.
Quand Israël élimine le chef du programme nucléaire iranien, il joue du billard à trois bandes pour saper la détente entre les États-Unis et l’Iran avant même que Biden n’entre en fonctions.
Quand Israël exige une déclaration palestinienne de reconnaissance totale avant de signer un accord, c’est un prétexte fallacieux pour torpiller ledit accord.
Les accords de normalisation d’Abraham sont pour les processeurs des « raisins acides. » Ils n’imaginaient pas qu’il existait un conflit israélo-arabe autonome qui ne se résumait pas exclusivement au conflit israélo-palestinien. Ils n’imaginaient pas que des Arabes allaient acter qu’Israël avait gagné sa légitimité, sans passer par une purification rituelle. Et que les Arabes voudraient passer à autre chose.
Par contre les professionnels de la paix ne seront pas en peine d’arguments pour démontrer que ces accords de normalisation ne sont que des fictions.
Pour certains d’entre eux, ils n’ont rien à voir avec la paix, car ils sont passés avec des pays non démocratiques.
D’ailleurs comment les associer à la paix puisqu’aucun de ces pays signataires n’a jamais été en guerre contre Israël. (Danie Lévy d’American Project). Et les avantages que les chefs arabes vont tirer de ces accords sont en fait « une sorte de corruption ».
Et pour ne pas faire dans la dentelle, Il a même été dit que les accords d’Abraham ce ne sont pas des accords de paix, mais des contrats d’armement. Si on voit les choses sous cet angle, la paix de Camp David de 1978 avec l’Égypte était alors un mega contrat d’armement.
2 Psychosociologie de la guilde
Shany Mor compare ces experts de la politique étrangère à une guilde, un groupe issu de toutes les familles politiques, uni par un puissant consensus, qui s’est assuré une espèce de monopole sur l’analyse et la décision dans la politique moyen-orientale des États-Unis. Ce qui le caractérise, ce n’est pas de faire des erreurs occasionnelles mais de « se tromper systématiquement » et de s’affranchir du réel en refusant de comprendre l’échec de ses anticipations et de ses prescriptions.
Selon Shany, le moteur des experts serait une position morale, semi-religieuse. Ils ne désirent pas tant prendre fait et cause pour les Palestiniens vaincus, que laver de leur impureté les Israéliens, « moralement et spirituellement déchus par leur victoire même. » La faute de la guilde serait « de confondre ses impulsions morales avec l’analyse stratégique. » C’est pour cela que sa mission est de ligoter Israël et le forcer à faire les compromis qui lui sont prescrits.
La thèse des pulsions morales des élites parait particulièrement fragile. S’il faut laver avec sévérité Israël de ses victoires, pourquoi ne pas laver de la même façon les Palestiniens de leur culture de violence et de suprémacisme islamique ? En politique tout court, et a fortiori en politique étrangère, la morale est davantage un subterfuge justificatif qu’un paramètre de la décision, elle active davantage l’émotion que la perception des enjeux. En d’autres termes, la rhétorique morale qui a justifié trois décennies d’accusations d’Israël et de cécité à l’endroit des Palestiniens n’était qu’un faux-fuyant pour masquer les calculs impopulaires des cercles dirigeants. La rhétorique morale n’est jamais l’axe de la décision, c’est un outil de communication.
Dans son commentaire détaillé de l’article de Shany Mor, Israël sauvé de lui-même[3], Michael Doran introduit des correctifs substantiels aux vues du chercheur, d’autant plus intéressants qu’il a été lui-même conseiller au Secrétariat à la Défense et directeur du Conseil de Sécurité nationale dans l’administration Bush II.
Doran souligne qu’en fait, les idées de la guilde étaient répandues, mais aussi vivement contestées, dans les milieux de la politique internationale. Sous Trump, quelques Républicains étaient partisans des positions de la guilde, et sous George W Bush les responsables de niveau ministériel se situaient en nombre égal de part et d’autre du clivage entre pro et anti Israël. « Le président G. W. Bush lui-même oscillait entre les deux camps selon les circonstances. » Inversement sous Obama les responsables de la politique étrangère partageaient une vision unique.
En fait Israël se situe sur une ligne de faille de la politique américaine. Si le soutien des Républicains à Israël a grimpé en flèche depuis 30 ans, plus le compteur se déporte vers la gauche démocrate plus on s’éloigne de l’État hébreu.
Ensuite, Michael Doran introduit un paramètre ignoré par Shany Mor, la politique intérieure. Les présidents attendent des spécialistes en politique étrangère des stratégies en phase avec les attentes de leur électorat. Ils ne le perdent jamais de vue. L’état de l’opinion influence donc la politique étrangère. Cela n’a pas empêché Barack Obama de défendre sur Israël et sur l’Iran des options de politique internationale impopulaires, mais cela l’a contraint à brouiller systématiquement les messages. La création de JStreet avait pour but de réduire la pression des Juifs modérés ou de gauche sur sa politique en les dissociant autant que possible d’Israël. On verra plus loin que l’impopularité de l’Iran, perçu à bon droit comme malfaisant en Amérique, est un obstacle à la reconfiguration des alliances régionales promue par Obama, et aujourd’hui par Biden.
La troisième remarque importante de Michael Doran porte sur les motifs de l’obsession israélienne chez les progressistes et d’autres catégories d’opposants farouches à l’État juif qui peuplent les bureaux du Département d’État et des think tank. La fixation irrationnelle, peut produire l’antisémitisme et l’antisionisme, mais aussi paradoxalement le pro-sionisme comme dans le cas des chrétiens évangéliques et des Juifs religieux. Il y a d’autre motifs, rationnels ceux-là, d’épouser la vision biaisée de la guilde. Si certains analystes considèrent que le conflit moyen-oriental est secondaire du point de vue des intérêts américains et qu’on peut ne pas s’en occuper, d’autres pensent qu’il creuse un fossé dommageable entre l’Amérique et les musulmans du monde entier, et qu’il faut le régler d’urgence pour qu’il cesse d’entacher l’image de la nation, même si ce règlement détériore les relations israélo-américaines.
Pour Michael Doran, d’autres opposants à Israël s’inscrivent dans deux courants religieux, le modernisme protestant et le cosmopolitisme missionnaire. Les modernistes protestants pensent que la fraternité humaine exige de faire tomber les barrières religieuses. Ils sont farouchement opposés au fondamentalisme chrétien et au littéralisme biblique où il s’abreuve. Naturellement, « les modernistes ont toujours regardé Israël d’un mauvais œil » car certaines versions du récit sioniste renvoient aux Écritures. On trouve à gauche une variante laïque de cette approche.
L’intrusion du courant du cosmopolitisme missionnaire dans les affaires étrangères de l’Amérique a de toutes autres sources. Il coïncide, nous explique Doran, avec l’utilisation des missionnaires protestants du Moyen Orient par le Département d’État et la CIA à la suite de la seconde guerre mondiale. Ces organes d’État avaient besoin d’un personnel de terrain, cultivé, connaissant bien les langues et les cultures locales. Ces missionnaire étaient en même temps furieusement antisionistes. Ils connaissaient la sensibilité des Arabes au conflit avec le sionisme et le soutien croissant que lui apportaient les États-Unis depuis les années 70 sous la pression de l’opinion. Ils imputaient naturellement l’échec de leur projet missionnaire, leur incapacité à jeter des pont avec les musulmans, au soutien de leur pays à Israël. Confondant projet missionnaire et intérêts des États-Unis, ce nouveau personnel des affaires étrangères a pesé pour une prise de distance systématique de l’Amérique avec Israël, la fameuse daylight d’Obama.
Michael Doran termine son analyse du sous-bassement sociologique de la pensée antisioniste aux États-Unis en insistant sur le caractère moral des Américains qui relèguent les fait de terrain du Moyen-Orient au second plan pour parler d’eux-mêmes en parlant d’Israël. C’est certainement vrai pour les Américains. Mais beaucoup moins pour les analystes professionnels et les acteurs politiques décisionnels.
3 – Les implications du 11 septembre
Pour approcher d’un peu plus près la prise de décision américaine en matière de politique moyen-orientale, très dommageable pour Israël, les circonstances du 11 septembre sont riches d’enseignements.
En déclarant la guerre contre le terrorisme et en lançant son offensive en Afghanistan, la présidence américaine donnait une réponse à une vive attente de l’opinion après les attentats traumatisants du 11 septembre. C’était donc avant tout une obligation de politique intérieure.
En même temps, il fallait prendre en compte la sensibilité de l’immense monde islamique et le rassurer sur les intentions « défensives » de la guerre contre le terrorisme même si elle se déroulait en terre d’Islam.
Pour cela, il fallait envoyer des « messages » positifs au monde musulman. Les plus à même d’être appréciés devant démontrer une prise de distance avec le Satan juif.
Mais, vu les dispositions de l’opinion intérieure américaine de plus en plus favorables à l’État juif ciblé par des attentats cruels, les messages anti-israéliens de solidarité avec les musulmans devaient être en partie masqués ou agrémentés de subterfuges moraux propres à les justifier.
La décision présidentielle ne pouvait éviter de prendre en compte simultanément des impératifs contradictoires : justifier la riposte à l’ennemi musulman, répondre à l’attente de vengeance de l’opinion intérieure, ménager la sensibilité de cette opinion à la cause d’Israël, rassurer la Oumma, montrer concrètement aux musulmans la distance entre l’Amérique et Israël, interdire un niveau excessif de violence contre Israël. La politique étrangère devrait mixer dans la durée ces contraintes incompatibles entre elles.
Les principales décisions américaines dans le conflit israélo-palestinien prises après le 11 septembre illustrent la stratégie de l’exécutif :
- Dès la proclamation de la guerre contre le terrorisme, Georges W Bush distingue les « terroristes » islamiques de toute nature qui ont attaqué l’Amérique, avec lesquels il entre en guerre, des groupes palestiniens qui mènent l’Intifada armée contre les civils sur le sol israélien. Cette distinction est un message au monde musulman pour l’assurer que le règlement comptes entre l’Amérique, les talibans, al Qaïda n’est pas une guerre contre la Oumma musulmane et qu’il ne faut pas confondre la guerre de l’Amérique et celle d’Israël.
- Le 29 mars 2002, après consultations, la présidence américaine autorise l’opération Rempart pour déloger les bases urbaines d’où partent les attentats-suicides de l’Intifada. La décision américaine qui vise à préserver la viabilité de l’État d’Israël reste confidentielle pour ne pas irriter les Oumma ;
- Le 24 juin 2002 G. W. Bush formule pour la première fois un projet de création d’un État palestinien. Cette proposition intervient à un moment de forte tension sur le terrain, où Israël qui tente de réduire les bases arrières des commandos suicides de l’Intifada, confine Yasser Arafat dans la Moukata. La violence armée aboutit donc à une mesure américaine d’apaisement, c’est-à-dire un gain politique inestimable pour les Palestiniens, envoyant au monde arabe un message de compréhension et de solidarité de l’Amérique ;
- Août/sept 2005 Le retrait d’Israël de Gaza. Il a été obtenu après de longues pressions américaines sur le gouvernement Sharon, malgré l’opposition du parti de gouvernement et des stratèges militaires qui anticipent la naissance d’une plateforme djihadiste agressive sur la frontière sud d’Israël. Ce résultat est un nouveau message de solidarité envoyé au monde arabe assurant que l’Amérique contribue au « containment » d’Israël et peut le faire reculer ;
- 25 janvier 2006 Les Américains exigent qu’Israël d’accorde au Hamas l’autorisation de participer aux élections parlementaires palestiniennes bien qu’il refuse de reconnaître les accords d’Oslo, cadre juridique de l’élection. Cette exigence intervient malgré la performance du Hamas aux précédentes municipales où il avait talonné le Fatah, laissant augurer une victoire ultérieure qui interviendra effectivement. La demande américaine ouvrira les portes du pouvoir total au parti du frère musulman Sheik Yassine. Elle sera suivie le 15 juin 2007 par éviction du Fatah de Gaza par le Hamas. Un émirat djihadiste, assis sur une population jeune et nombreuse, prend forme à la frontière d’Israël.
- 27 novembre 2007 Ouverture de la Conférence d’Annapolis à l’initiative des États-Unis. Elle prévoit la signature d’un accord final au plus tard pour la fin de 2008 sur la base des demande palestiniennes. C’est un témoignage de plus que l’Amérique partage la cause des Palestiniens et donc du monde musulman dans son ensemble, au détriment de l’arrogance israélienne. L’opération se termine en queue de poisson. L’offre de paix conforme aux prescriptions américaines présentée par Ehoud Olmert à Mahmoud Abbas est rejetée le 16 septembre 2008.
Ce qui était cohérent vu du bureau ovale allait coûter très cher à Israël à peine sorti des flammes de l’intifada sur son minuscule territoire. Avait-il été « poussé sous les roues du bus » par son très puissant mentor ? Le bilan sera sévère pour l’État juif :
- Quatre guerres avec le Hamas, suivies d’une dégradation continue de son image internationale et de la dégringolade de son pouvoir de dissuasion ;
- Une situation de confrontation permanente avec un émirat belliciste tirant à tous coups des dividendes politiques et financiers de ses provocations violentes ou carrément armées. Israël est le seul pays au monde visé régulièrement par des ballons incendiaires dans une région aride du globe où sévissent de monstrueux feux de forêt, quand ailleurs, un mégot jeté d’une voiture vous conduit directement en prison :
- La présence à sa frontière sud d’une porte d’entrée pour la stratégie d’encerclement de l’Iran :
- Une guerre politique et judiciaire permanente (lawfare) dans les instances du multilatéralisme international.
Cependant, le risque d’un État palestinien vite transformé en porte-avion du jihad aura été évité par un providentiel refus palestinien de plus.
4 – La politique de réalignement
L’exemple précédent montre à quel point la poursuite des intérêts américains, tels que les entend la présidence du moment, peut mettre en danger la pérennité d’Israël. Les deux mandats d’Obama ont été dominés par « l’engagement » pour redresser les relations avec le monde musulman durement affectées par les guerres d’Afghanistan et d’Irak, sans oublier celle de Libye et même du Mali menées « from behind. » Ils seront pour Israël un long chemin au bord du précipice lors du rapprochement avec l’Iran. C’est ce legs qui est reçu aujourd’hui avec enthousiasme par les équipes de Biden. Et c’est le cœur, on l’a vu, du dilemme existentiel actuellement posé à Israël. D‘un coté la promotion de l’Iran au rang de mentor régional et le retour de la question palestinienne comme matrice inusable de pressions politiques et morales, poussent une fois de plus Israël sous les roues du bus. De l’autre , la nécessité du support de l’Amérique sur les champs diplomatique, militaire, technologique et économique est d’une importance tout aussi vitale pour l’état juif.
Entre les deux, la politique, c’est-à-dire un diagnostic pertinent des contraintes respectives, beaucoup d’habileté diplomatique, et l’exploitation des opportunités.
Le réalignement[4] est le nom que donne Michael Doran à son article sur le projet d’un nouvel ordre au Moyen-Orient, entamé par Barack Obama dès son premier mandat, et assumé aujourd’hui par le carré Biden-Malley-Blinken-Sullivan. Que veut l’Amérique officielle et comment s’y prend-elle ?
Le premier objectif américain, très consensuel, est de quitter le cycle des guerres moyen-orientales pour recentrer ses ressources sur le bien-être national, l’environnement, et naturellement la concurrence multiforme avec la Chine, une puissance avec laquelle elle est engagée volens nolens dans un piège de Thucydide[5]. Des personnalités éminentes qui font le pont entre les présidences Obama et Biden comme Robert Malley et Ben Rhodes, vont beaucoup plus loin. Ben Rhodes, par exemple, pense « que le pays a besoin d’une correction structurelle, et pas seulement d’un changement de cap…. Il ne suffit pas de réorienter le paquebot ; Biden et le Congrès doivent le redessiner »[6] Il en arrive même à proposer de « changer la mentalité sécuritaire.. [et]… remodeler l’identité américaine chez nous. »
Comment obtenir le retrait du Moyen-Orient ? Si Donald Trump partageait la même finalité qu’Obama et Biden, son approche par la « pression maximale » sur l’Iran et le soutien aux alliés traditionnels était aux antipodes de la vision de son prédécesseur et de son successeur. Biden, qui, comme Obama, veut éviter à tout prix l’épreuve de force, va se livrer à une immense opération de séduction des mollahs, leur offrant d’emblée et sans contrepartie une profonde corbeille de dollars. Sous la forme de la libération des fonds gelés en Corée du sud, en Irak et à Oman, de l’encouragement des Chinois à acquérir du pétrole iranien, et du consentement à un prêt de 5 milliards de dollar du FMI.
Ce n’est là qu’une facette du numéro de charme de Biden; il y en a d’autres, plus décisives. D’abord la disqualification de ses propres alliés, ennemis régionaux de l’Iran. Ce sera le retrait des Houthis de la liste des organisations terroristes, la récusation de Mohamed Ben Salmane accusé de meurtre, la suspension des ventes d’armes « offensives » à l’Arabie saoudite, la disqualification masquée des accords d’Abraham, le torpillage souterrain de « la guerre entre les guerres » d’Israël et de ses opérations contre le programme nucléaire. Ensuite, l’Amérique va reconnaitre les ‘’équités de l’Iran’’, un « terme utilisé par Obama pour décrire les positions de pouvoir de l’Iran », autrement dit ses conquêtes territoriales au sein de l’arc chiite et en dehors. Comme le formule Michael Doran, « l’Amérique utilise son influence pour élever les intérêts de l’Iran au-dessus de ceux des alliés des États-Unis dans les zones clés du Moyen-Orient,»[7] en Syrie, au Yémen, en Irak. Et au moment de la négociation sur le retour à l’accord nucléaire de 2015, l’Amérique n’oppose que lea parole chevrotante de Blinken aux viols répétés des engagements qui conduisent Téhéran au seuil de l’arme nucléaire.
Mais que veut l’Iran ? Schématiquement, et comme le démontrent des faits qu’il faut être aveugle pour ne pas voir, l’Iran aspire à obtenir un dispositif nucléaire et balistique faisant fonction de bouclier du régime et de vecteur de projection de son pouvoir. Il veut contrôler les territoire du cœur du Moyen-Orient et les ressources stratégiques du Golfe; il veut assumer le leadership régional grâce en particulier à son engagement répété de rayer Israël de la carte. On ne retient pas ici les engagement religieux d’imposer l’Islam à la planète et de détrôner l’hégémonie sunnite sur le monde musulman.
Ces objectifs sont patiemment menés depuis des décennies grâce à un programme nucléaire et balistique d’abord dissimulé, qui éclate aujourd’hui sans frein à la face du monde après les simagrées de l’accord de Vienne. Au plan tactique l’Iran projette son pouvoir au moyen de proto-États comme les Hezbollah (Liban , Irak, Yemen), le Hamas, les Jihad islamiques, et des milices éparpillées sur de multiples fronts de guerre.
Israël est placé au centre de sa cible par une manœuvre d’encerclement (Gaza, Liban, Syrie) et le déploiement de dispositifs balistiques, de drones et d’infanterie au plus près, sans compter les moyens nucléaires en phase d’aboutissement.
Le réalignement, ce vaste renversement d’alliances des Américains visant à concéder à l’Iran une latitude d’action complète au Moyen-Orient, ne semble pas compatible avec la survie d’Israël s’il réussissait. Mais ce renversement est-il réellement possible et va-t-il réussir ?
Il se heurte à de plusieurs obstacles.
- La faiblesse politique de l’administration Biden qui vient se subir une perte de crédibilité brutale sur la scène américaine avec la débandade d’Afghanistan ;
- L’image exécrable de l’Iran aux États-Unis ne facilite pas un consensus « obamiste » pour tout concéder aux mollahs ;
- Le refus de négocier des mollahs avec le Grand Satan, réaffirmé par le président Ebrahim Raïssi. L’Iran ne veut pas s’accommoder de l’Amérique, il veut gommer définitivement l’empreinte de l’Oncle Sam de la carte du Moyen-Orient.
D’autre part, si l’Iran est menaçant, si l’administration Biden fait tout pour le séduire, son socle est fragile et rien ne permet de penser qu’il ait les moyens de maintenir son ordre sur les territoires et les populations sunnites qu’il convoite, ni qu’il puisse contenir encore longtemps le rejet violent de son peuple.
En d’autres termes, le pire n’est pas toujours sûr.
[1] Interim National Security Strategic Guidance, March 03, 2021, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf
[2] The Return of the Peace Processors, Shany Mor, 01 février 202 https://mosaicmagazine.com/essay/israel-zionism/2021/02/the-return-of-the-peace-processors/
[3] Saving Israel in Spite of Herself, Michael Doran, 08 Febr. 2021 https://mosaicmagazine.com/response/israel-zionism/2021/02/saving-israel-in-spite-of-herself/
[4] The Realignment, par Michael Doran et Tony Badran, 10 mai 2021, https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/realignment-iran-biden-obama-michael-doran-tony-badran
[5] Voir Vers la guerre: L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide? Graham Allison, Odile Jacob, 2019
[6] Them and Us – How America Lets Its Enemies Hijack Its Foreign Policy, par Ben Rhodes, Foreign Affairs, Septembre/Octobre 2021 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-24/foreign-policy-them-and-us
[7] The Realignment, op. cit.