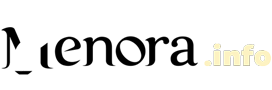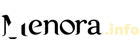Il existe une tension entre l’histoire comme discipline, cherchant à se fonder sur des sources et tendant à l’objectivité factuelle, et l’histoire comme récit idéologique, servant à exalter des causes, à fustiger des adversaires et à justifier une action politique. Dans ce dernier cas, le récit prétend à une vérité légitimante et l’histoire se confond avec une vaste entreprise rhétorique consistant à organiser le réel en fonction de catégories mythéologiques : victoires, conquêtes, résistances se déclinent alors selon des jugements de valeurs qui versent volontiers dans le manichéisme. Les notions y sont alors porteuses d’interprétations dont la circulation permet la validation. L’enjeu de l’histoire comme propagande est de réussir à diffuser les interprétations qui conviennent à un pouvoir. Comme le rappelle Jean-Pierre Faye, « il existe, dans l’histoire un effet de production d’action par le récit »[1].
On constate ainsi que l’accusation de colonisation, de racisme, d’apartheid est devenue un procédé narratif permettant de condamner l’Occident et de le pétrifier dans une culpabilité qui l’affaiblit et le rend perméable à des influences étrangères. Ces accusations sont plus particulièrement dirigées contre Israël, au point de miner sa légitimité nationale et culturelle. De fait, la consultation d’un moteur de recherche fait apparaître, en tout premier lieu, le mot apartheid en collocation avec Israël et non pas avec l’Afrique du Sud, ni d’ailleurs avec aucun autre pays pratiquant une discrimination juridique entre ses populations. Le concept d’apartheid est bien l’un des outils de la réprobation d’Israël. Il est même désormais un lieu commun discursif indissociable d’Israël dans le discours militant dont l’objectif est d’en faire une réalité narrative irrémédiable. Il faut pourtant revenir sur la singularité historique de l’apartheid pour en concevoir l’unicité culturelle.
Origines historiques
Le mot apartheid provient de l’afrikaans, langue dérivée du néerlandais, développée par les Boers, colons installés au XVIIe siècle au Cap de Bonne Espérance, qui n’est alors qu’un comptoir commercial tenu par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Dès le XVIIIe siècle, les Boers viennent à se considérer comme Afrikaners, c’est-à-dire à se distinguer des Néerlandais de métropole : ils vont alors s’opposer à la Compagnie dont l’administration coloniale dépend de ce qu’on appelle alors les Provinces-Unies. Le Cap et sa région passent progressivement sous contrôle de la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle qui désire ainsi contrer l’influence régionale de Napoléon. Les Pays-Bas ne voient le jour qu’en 1815, à la suite de Traité de Paris qui signe la fin de l’Empire napoléonien après la bataille de Waterloo. Dans le contexte des guerres anglaises contre les Zoulous entre 1876 et 1879, se développera la rébellion des Boers contre le pouvoir anglais. Les « Guerres des Boers », contre le pouvoir colonial anglais en 1880 et 1899 mèneront au statut de dominion en 1910 et à l’indépendance en 1961. L’Afrique du Sud est, de fait, une colonie émancipée de sa tutelle néerlandaise puis britatnnique.
La ségrégation de fait qui existe entre populations africaines et populations d’origine européenne (néerlandaises et anglaises) repose sur divers facteurs, dont le contrôle de la main d’œuvre et la mise en place d’un pouvoir fondée sur la supériorité raciale blanche. La création de laisser-passer, des zones résidentielles distinctes, l’organisation d’un droit de vote racial et censitaire et la mise en place d’une colour bar se développent juridiquement de manière progressive au fil de lois diverses (1923, Native Urban Areas Act). Le fondement de la hiérarchisation raciale est clairement la suprématie blanche opposant les maîtres blancs et les travailleurs noirs.
Le concept d’apartheid, c’est-à-dire littéralement « le fait d’être à part », renvoie à cette histoire et à la façon dont le pouvoir afrikaans a établi une ségrégation raciale inégalitaire dont la portée était juridique, économique et culturelle. La création des bantoustans, la régulation de l’accès aux services et aux lieux publics, la représentation politique (provinces noires représentées par des blancs), l’accès à la propriété immobilière, l’inégalité de l’enseignement (les zoulous recevaient une éducation « limitée à leurs besoins immédiats »), etc. ont ainsi construit une société dont la mixité était juridiquement exclue.
Héritière d’une situation coloniale, la société afrikaaner répondait à une logique de suprématisme racial, de séparation ethnique et de domination économique. L’histoire et les fondements d’Israël sont de nature profondément différente puisque les Juifs sont un peuple autochtone, conquis, opprimé et débouté de sa souveraineté depuis des siècles et dont la renaissance nationale en 1948 est l’expression de son autonomie politique en tant que peuple. C’est aussi une nation dont la situation politique est déterminée par les agressions constantes de ses voisins (1948, 1967, 1973) et de diverses entités belligérantes (Hamas, Hezbollah, etc.), sa survie étant conditionnée par des mesures sécuritaires spécifiques. La comparaison avec Israël est donc totalement infondée, historiquement et socialement : il n’existe aucune ambition de séparation ethnique en Israël qui est l’une des sociétés les plus multiraciales au monde avec de nombreuses minorités (Arabes, Druzes, Érythréens, Circassiens…) disposant toutes des mêmes droits.
Discrimination, ségrégation, inégalités
Dans la société, toute différence n’est pas une inégalité et toute inégalité n’est pas nécessairement intentionnelle ou juridiquement matérialisée. L’emploi du terme discrimination est donc lui-même susceptible d’interprétations diverses selon qu’il désigne une discrimination établie, juridiquement ou culturellement, c’est-à-dire reconnue par les institutions d’un pays ou bien selon qu’il renvoie à des inégalités sociales qu’il désigne alors essentiellement par hyperbole et analogie. Les discriminations ou inégalités sociales ne sont pas constitutives d’un système de gouvernement, or l’apartheid se définit comme régime fondé sur la discrimination et la séparation.
La séparation fondée sur l’ethnie ou la religion, de facto ou de jure, existe ou a existé dans de nombreuses configurations. Le ghetto juif est en Europe et le mellah ou hara en Afrique du nord est l’incarnation même d’une ségrégation spatiale relayant une ségrégation juridique. La Révolution Française émancipera les Juifs des discriminations fiscales des dominations locales. Ils seront enfin pleinement intégrés à la Nation comme citoyens en 1807 par les douze questions posées aux Juifs par Napoléon dans le cadre du Grand Sanhédrin afin de leur faire reconnaitre la loi française.
Le Maghreb n’a pas connu une telle intégration des Juifs à la citoyenneté puisqu’elle a toujours été conditionnée par l’appartenance à l’islam : les Juifs du Maghreb n’y ont donc acquis une pleine citoyenneté que lors de la période de colonisation européenne. Quand cette dernière a pris fin, la pression politique et les pogroms les ont chassés : l’épuration ethnico-religieuse du Maghreb, débutée avant la Seconde guerre mondiale, s’est concrétisée après-guerre avec les diverses indépendances en causant le départ d’environ 900 000 Juifs, vers Israël, l’Europe et les USA.
Plus largement, le statut de dhimmi dans le monde musulman définit à ses minorités religieuses un statut légal de dominés. La forme spécifique que cela prendra dans l’Empire Ottoman, les millets reconnaissent de la même manière une séparation sous la forme de la domination.
À des degrés et dans des dimensions variées, qui comprennent l’absence de liberté de conscience pour les minorités religieuses ou l’esclavage, de nombreux pays musulmans pratiquent différentes formes de discriminations collectives : Libye, Mauritanie, Malaisie, Arabie Saoudite, Qatar, Maroc, Tunisie, etc.
Pourtant, le terme d’apartheid n’est que rarement appliqué à ces pays et dans le consensus de la culture politique occidentale, ces pays ne sont pas associés à ce mot. De fait, il semblerait anachronique de décrire la situation des non-musulmans dans l’Empire ottoman comme relevant d’un apartheid. Pourtant, c’est bien une situation de discrimination juridique patente qui est comparable. En revanche, apartheid s’applique volontiers à Israël et l’association des deux mots est même devenue incontournable dans l’esprit non seulement des discours militants mais dans le vocabulaire du discours journalistique.
Mutations sémantiques
En linguistique, on parle de néologie sémantique quand un mot prend un nouveau sens. La trajectoire du mot apartheid est un cas de néologie sémantique dans la mesure où il ne décrit plus seulement la situation politique de l’Afrique du Sud, mais est devenu une catégorie juridique, notamment dans le « crime pour apartheid » (défini par l’assemblée général de l’ONU en 1973). Plus largement encore, dans la langue courante, apartheid sert désormais à décrire une situation d’inégalité entre groupes sociaux dans d’autres contextes nationaux que l’Afrique du Sud. On a même vu le mot apartheid resurgir récemment pour critiquer l’instauration d’un passe sanitaire en France
.
Or, si la transformation d’un événement historique en une catégorie du politique n’est pas un phénomène rare, elle ne va jamais sans certaines distorsions axiologiques.[2] Par exemple, définir une loi un comportement ou une politique comme fasciste constitue une extension analogique qui applique des caractéristiques de ce moment historique de l’histoire italienne pour les considérer comme composantes d’un corpus idéologique qui devient applicable à d’autres situations. Il en va de même du mot ghetto, initialement appliqué aux seuls Juifs à Venise au XVIe siècle, devenu un concept social décrivant toute situation d’inégalité dans la géographie urbaine où qu’elle soit. On pourrait étendre ce phénomène à des mots comme démocratie ou agora qui décrivaient des réalités grecques ou à des mots comme thatchérisme, gaullisme, keynesianisme qui ont désigné des politiques avant d’être plus ou moins considérés comme des doctrines et de servir à décrire d’autres circonstances historiques.
Ce n’est pas le sort de tous les termes politiques car seuls certains connaissent cette extension conceptuelle là où d’autres restent plutôt ancrés dans une réalité spécifique (carlisme, phalangisme, boulangisme). Il faudrait aussi étudier la façon dont, inversement, on transforme parfois des concepts génériques en les faisant essentiellement correspondre à une seule situation historique. C’est ainsi que colonisation ou esclavage sont aujourd’hui tendancieusement utilisés pour décrire uniquement la colonisation européenne du XIXe siècle et le commerce triangulaire du XVIIIe siècle, sans prendre en compte toutes les autres situations historiques de colonisation et d’esclavage.[3]
L’extension sémantique de tels termes repose sur le passage d’une valeur désignative spécifique, c’est-à-dire historiquement située, à leur reconfiguration comme concepts. Le terme ne désigne plus alors la situation d’origine mais la prend comme référence conceptuelle, comme modèle dont on se sert pour l’appliquer, par filiation, analogie, comparaison, à d’autres situations[4].
Ce sont donc des termes qui sont porteurs d’une confusion fondamentale : aucun événement historique n’étant, ontologiquement, identique à un autre, l’emploi de ces termes se fonde forcément sur une ressemblance et non sur une identité. Les contours sémantiques de ces mots s’appuient donc sur certains traits, envisagés implicitement comme définitoires, mais qui constituent une interprétation de l’histoire, laquelle ne saurait être qu’idéologique.
La notion de démocratie est ainsi considérée positivement dans la langue française alors que la notion de fascisme possède des connotations négatives : indépendamment des réalités historiques — la démocratie athénienne est loin de ressembler à la nôtre — l’emploi du terme implique une forme de jugement idéologique plus ou moins nécessairement anachronique. L’objectivation scientifique consiste à démêler la référence historique spécifique et la conceptualisation abstraite générique.
Dans le cas du concept d’apartheid, il est remarquable de noter que son extension nait avec la disparition de l’apartheid historique en Afrique du Sud et que son transfert désignatif pour accuser Israël s’est notamment réalisé lors de la Conférence de Durban en septembre 2001, événement fondateur de la criminalisation contemporaine d’Israël par les puissances islamiques qui ont, à cette occasion, trouvé dans le vocabulaire des droits de l’homme les ressources de cette allégation. Depuis, c’est devenu un poncif des campagnes médiatiques d’associations comme B’Tselem ou Human Rights Watch qui utilisent le terme apartheid de manière à en faire une accusation juridique.
Oubliant la situation d’agression permanente dont est victime Israël, ce discours transforme toute mesure sécuritaire en injustice séparatiste : ce retournement rhétorique fait donc du djihadisme palestinien la victime d’un État présenté comme suprématiste. Dans l’oubli du référent fondateur d’apartheid qu’est la société afrikaner, seule la captation de connotations négatives persiste, indépendamment des faits réels. C’est un cas d’habituation discursive qui a fini par transformer une insulte hyperbolique en doxa.
Mutation idéologique
C’est précisément le consensus idéologique contre l’apartheid qui en fait désormais un concept accusateur et non descriptif. Tel est le sort des notions qui deviennent des parangons de négativité : racisme, sexisme, fascisme, etc. Une fois passées dans le consensus social, elles servent à délégitimer les adversaires et non plus à décrire réellement une situation politique. La société est saturée de tels discours où les notions circulent avec le naturel de l’évidence alors que leur manipulation est un enjeu de pouvoir déterminant. L’effet de justification de telles notions sert de levier diplomatique : c’est bien au nom de l’antiracisme que s’était déchaîné l’antisémitisme à Durban en septembre 2001. Derrière le consensus idéologique porté par ce lexique on trouve l’hypocrisie de l’exploitation politique.
Par un puissant effet de propagande discursive, l’utilisation massive d’une analogie délégitimant Israël a transformé le sens même du mot apartheid pour lui conférer une valeur négative et non plus une valeur descriptive. Car si apartheid désignait une configuration juridique et sociale particulière propre à l’Afrique du Sud, le mot ne peut s’appliquer à la situation israélienne sans constituer un mensonge social. Alors qu’il pourrait s’appliquer à tous les pays pratiquant une discrimination juridique de séparation entre ses citoyens, il s’est attaché uniquement à Israël, qui ne le pratique pas.
En effet, les droits sont les mêmes pour tous les citoyens d’Israël. Les Arabes israéliens servent dans l’armée, siègent à la Cour Suprême, et n’ont aucune interdiction de pratiquer la profession de leur choix. Il y a même des députés islamistes et anti-israéliens à la Knesset. S’il existe des mesures sécuritaires, elles sont éminemment justifiées tant le pays doit faire face à des attentats et des attaques de manière constante. Les événements de mai 2021 ont justement montré que l’antisémitisme des populations musulmanes pouvait s’exprimer, justement dans des villes mixtes, où elles se sont livrées à des violences anti-juives à Lod, Yafo, Akko ou Haifa.
L’accusation d’apartheid va de pair avec celle de vouloir imposer la « suprématie juive ». Cette locution trompeuse calque l’idéologie raciale afrikaner qui se fondait sur une prétention à la supériorité. Le droit à l’autodétermination du peuple juif est ainsi par ce seul biais lexical présenté comme une injustice. La diabolisation est patente car pareille accusation gratuite pourrait être construite, de façon purement proclamative, pour tout État : « suprématie espagnole », « suprématie française », « suprématie britannique », « suprématie italienne », etc.
De fait, si le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne semble pas poser de problème quand les Arabes de Palestine choisissent de se déterminer comme communauté musulmane, on trouvera illégitime qu’Israël se détermine comme communauté juive. De la même manière, l’accusation d’apartheid ne porte que sur Israël — qui intègre 20% de population arabo-musulmane — là où l’Autorité Palestinienne se déclare a priori intolérante à toute présence juive sur ses terres, véritable apartheid fondée sur un État appelé à être judenrein. Tel est le double discours des puissances islamiques : la dénonciation de l’apartheid israélien comme discours à destination de l’Occident, où sa condamnation est un consensus moral et, d’autre part, une organisation sociale islamique qui ne tolère de présence juive ou chrétienne que subordonnée à la charia dans une condition de dhimmi.
Comme on le voit, le pouvoir d’évocation lexicale du mot apartheid supplante les réalités politiques dont de tels concepts sont censés rendre compte. Le mythe de l’apartheid relève de ce que j’ai pu décrire ailleurs comme une « mythéologie », autrement dit un récit faux mais dont la propagation comme mythe politique sert des intérêts idéologiques.
L’exploitation du consensus moral négatif qui entoure des notions délégitimantes mène ainsi à une guerre rhétorique dont les faits sont exclus. Le mythos remplace le logos : la factualité socio-historique est débordée par sa représentation mythifiée, fable corrompue par sa manipulation narrative.
Conclusion
Avatar des retournements victimaires qui ne cessent de peser sur Israël et les Juifs, l’accusation d’apartheid vient parachever le narratif accusatoire qui s’articule essentiellement sur le recours imprécatoire à un lexique de délégitimation. Ce sont donc les Juifs, qui ont vécu la majorité de leur histoire dans la condition de victimes de l’apartheid — dhimmi en terre d’islam, opprimés dans les ghettos européens — auxquels on applique un concept dirimant, accusation d’autant plus injuste qu’elle n’est en rien fondatrice de la société israélienne alors qu’elle reste déterminante dans le monde arabo-musulman.
La mutation sémantique d’un terme historique devenant un concept politique est relativement courante mais une telle évolution n’est pas uniquement conceptuelle : elle est susceptible de prendre place dans un cadre qui est celui de l’instrumentalisation militante.
On pourra faire le parallèle avec la façon dont Palestine a changé de référent, passant d’un sens géographique où il décrivait une région à un sens politique construisant par sa seule appropriation dénominative la prétention à fonder un État national arabo-musulman qui n’avait jamais existé en lui conférant une légitimité historique — qui est par contre refusée à l’État juif. Comme le montrent les discours d’atténuation et de justification du terrorisme, c’est par l’artifice langagier que l’on excuse le passage à l’acte et qu’on en prépare l’acceptation sociale. Le langage est ainsi enrôlé comme moteur fondateur d’une action, diplomatique autant que militaire, drapée dans la rhétorique conjointe de la légitimité et de la délégitimation. Le mot apartheid appartient désormais à l’arsenal rhétorique du militantisme sans avoir la moindre pertinence descriptive. Il entre dans le corpus général d’une économie narrative et lexicale dont le rapport pervers à la vérité sert les basses œuvres de la violence.
[1] Jean-Pierre Faye, p. 21. Introduction aux langages totalitaires. Théorie et transformation du récit, Hermann, 2003.
[2] Nous n’aborderons pas la question théorique de savoir s’il s’agit de néologie ou de mutation sémantiques, de métonymie ou encore de formes d’antonomase ou d’éponymie. L’essentiel est bien de constater ici une évolution de sens solidaire d’une exploitation rhétorique et politique.
[3] On peut songer aussi à un emploi du mot communisme pour désigner non pas un corpus idéologique mais son application historique en Russie, ce qui en fait un dans ces cas-là un synonyme de soviétique.
[4] Notons aussi que ce phénomène discursif et représentationnel est éminemment culturel et se développe différemment selon les langues et les époques. On remarque ainsi que nazi en américain est une hyperbole relativement banale signifiant « fondamentaliste », comme dans l’expression grammar nazi pour désigner quelqu’un de tatillon sur les questions de correction linguistique)