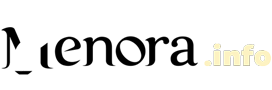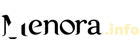Depuis la fin du printemps, au moins une fois par semaine, des Israéliens descendent dans la rue, par centaines et souvent par milliers, pour manifester contre Benyamin Netanyahou. Sans véritable leader mais avec des dizaines d’acteurs, cette contestation sur fond de crise sanitaire apparait à la fois comme un agrégat en formation et une décomposition sociale.
Depuis l’éruption de la pandémie de Covid-19, les lieux traditionnels de socialisation ont disparu, en tout cas pour un temps. Comment se forme et s’exprime une opinion publique, quand il n’y a plus de rencontre dans la sphère privée, familiale ou amicale, dans les restaurants et les cafés, sur le lieu de travail, dans les synagogues ou les établissements d’enseignement ? Par où passe l’humeur du peuple ?
Naissance de la contestation Balfour
En Israël, la campagne actuelle de contestation trouve son origine dans plusieurs mouvements, qui avaient débuté dès 2017 et qui protestaient contre la corruption présumée de membres du gouvernement, d’hommes d’affaires et de hauts fonctionnaires dans des marchés publics, comme l’exploitation des champs gaziers en Méditerranée ou l’achat de sous-marins au groupe allemand Thyssenkrupp. Des manifestations réclamaient déjà la démission de Benyamin Netanyahou et faisaient pression sur le Conseiller Juridique du Gouvernement israélien, Avichaï Mandelblit pour qu’il mette en examen le chef de l’exécutif. On retrouve certains des acteurs de ces campagnes, auxquels se sont ajoutés de nouveaux mouvements (voir article : « Les acteurs de la contestation ») dans les manifestations organisées depuis le mois de mai 2020 contre Benyamin Netanyahou.
Le premier point de ralliement est la résidence du Premier ministre, rue Balfour, dans le centre résidentiel de Jérusalem, où quelques activistes comme Amir Haskel ont d’abord installé leur sit-in de protestation. Et c’est là que depuis plusieurs mois se tiennent les principaux rassemblements. Ce qui a donné le nom générique de « Balfour » au mouvement de contestation, même quand les manifestations se déroulent à Tel Aviv ou en d’autres points du pays. Ces événements sont inédits en Israël, en ce qu’ils sont des sortes de happening qui mêlent revendications politiques, sociales, sectorielles et expressions de contre-culture.
Le public de la contestation a évolué au fil des mois. Au noyau idéologique de départ, plutôt âgé, ashkénaze et laïc, se sont ajoutées des populations plus jeunes. Les grands rassemblements hebdomadaires s’organisent sur les réseaux sociaux et drainent un public d’étudiants, de jeunes adultes, mais aussi de familles. D’abord limités au centre du pays, les contestataires se sont aussi exprimés dans les localités de la périphérie d’Israël. Lors du deuxième confinement, on a aussi vu des retraités descendre dans la rue, mus par ce qu’ils perçoivent comme un éclatement du modèle sociétal qu’ils connaissaient jusque-là.
En dépit des mesures de limitation des rassemblements puis du reconfinement généralisé à la fin du mois de septembre, les manifestations ont donc continué. Quand les regroupements ont été limités à 20 personnes, on a vu se multiplier des rassemblements de proximité, généralement statiques, organisés par des riverains qui se fixaient rendez-vous sur les réseaux sociaux, en particulier sur les groupes WhatsApp, et baptisés « capsules Balfour » et qui se retrouvaient sur les carrefours, les places ou les ponts de voies rapides, dans de nombreuses localités à travers Israël. Si les grands rassemblements attirent surtout un public de jeunes adultes, les manifestations locales sont plus fréquentées par des familles et des personnes âgées. Selon une enquête réalisée par l’Institut pour la Démocratie en Israël, environ 10% des Israéliens auraient déjà participé à divers mouvements de contestation.
Même cible, objectifs différents. Les nostalgiques et les révolutionnaires
Les mots d’ordre de ces manifestations, qu’il faut distinguer des contestations socio-économiques, ont un dénominateur commun : l’appel à la démission du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Mais autour de ce message s’articulent des expressions diverses, de dénonciation de la corruption du système politique, du recul de la démocratie, de préoccupation sectorielle, de la gestion de la crise sanitaire et économique, mais aussi d’appels aux réformes, voire à la révolution. Pourtant, elles ne sont pas accompagnées d’un véritable programme qui serait une alternative au système en place. On peut toutefois distinguer deux tendances majeures : les nostalgiques et les révolutionnaires. Les premiers militent pour un retour aux valeurs qui ont accompagné la création de l’Etat, de solidarité nationale, d’égalité et de morale politique. Les seconds considèrent que le système est vicié depuis le départ et qu’il doit être remplacé.
Les nostalgiques sont par essence les manifestants les plus âgés, ceux qui se considèrent comme l’élite du pays qui a contribué à sa construction et à sa consolidation. Une des personnalités emblématiques de cette catégorie est Amir Haskel, un des fondateurs du groupe Ein Matsav. L’ancien pilote de Tsahal et historien de la Shoah, appartient clairement à l’élite ashkénaze. Il avait pourtant défrayé la chronique, quand les médias avaient diffusé des images de son altercation, fin août, avec une jeune policière d’origine éthiopienne, qui participait à la dispersion d’une manifestation. Haskel s’en était pris à elle en lui rappelant que c’était lui qui « était allé chercher [ses] parents en Ethiopie », alors qu’il servait comme pilote dans l’armée israélienne et qu’elle devrait « avoir honte ». L’ancien officier avait ensuite présenté des excuses. Un dérapage pourtant révélateur.
Les révolutionnaires se retrouvent parmi les contestataires plus jeunes. Ceux qui considèrent que ce n’est pas seulement le Premier ministre qui doit disparaitre de la scène, mais l’ensemble du système. Ces contestataires, sans véritable organisation centrale, se regroupent dans différentes structures, créées sur les réseaux sociaux. C’est souvent à partir d’une mobilisation ponctuelle pour un appel à manifester, qu’elles se sont pérennisées en mouvement. Si l’on retrouve parmi ces protestataires des activistes qui avaient participé à la contestation sociale de 2011 et dont certains ont évolué vers l’extrême-gauche, les autres acteurs de ce courant sont des jeunes, sans passé militant. Leurs revendications prennent pour cible une société inégalitaire, corrompue dans ses institutions et clivante dans son modèle économique. S’ils brandissent eux aussi des drapeaux d’Israël, ils considèrent pourtant que le modèle porté par leurs ainés a failli.
Slogans et logos
La diversité des slogans témoigne du caractère hétéroclite de la contestation. Contrairement au mouvement de 2011 qui se concentrait sur une revendication de justice sociale, celui de 2020 rayonne dans toutes les directions. Appels à la justice, à la sauvegarde de la démocratie et à l’égalité ou même à la révolution, se déclinent sur les banderoles imprimées comme sur les pancartes artisanales. De « Bibi rentre chez toi ! » à « Pas de pardon pour la corruption », les slogans les plus nombreux visent le Premier ministre israélien. Le plus reproduit est certainement « Leh’! », « Dégage ! », référence au slogan anti-Moubarak des manifestations du Printemps arabe en Egypte. Non seulement il est le plus court – deux lettres en hébreu – mais surtout il reprend le graphisme du logo du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou. C’est la création du scénariste et activiste Rony Donewitz, qui est aussi à l’origine du logo du mouvement « Ein Matsav ». Pour Donewitz, c’est la référence au sigle du Likoud – inchangé depuis 1977 et donc très familier au public israélien – combinée à la brièveté du message, qui explique son succès et le fait qu’il est devenu, en quelques semaines, une des plus fortes identifications graphiques du mouvement.
Le financement de la contestation
Les partis politiques sont absents de cette contestation. Il fait dire qu’ils sont limités dans leur capacité à organiser des manifestations. L’infrastructure des cellules locales a pratiquement disparu et avec elle la capacité de mobilisation. La loi sur le financement des partis politiques, beaucoup plus stricte que par le passé, est également un obstacle. La législation est en revanche nettement plus souple pour les organisations qui n’entrent pas dans cette catégorie. Elles peuvent faire appel à des dons privés, d’associations ou de fondations. C’est le cas du Keren Israël Hah’adasha, le New Israel Fund, qui subventionne ponctuellement ou régulièrement diverses organisations et associations. Pourtant, leur influence semble marginale dans la campagne actuelle.
D’ailleurs, les militants des différents mouvements de contestation se défendent d’être financés par des organisations extérieures. Au début de l’été, un message diffusé sur les réseaux sociaux et repris par l’ensemble des mouvements affirmait que certains d’entre eux avaient effectivement été approchés par des organismes qu’ils n’ont pas nommés, et qui leur proposaient un soutien logistique et financier, qu’ils disent avoir refusé en bloc.
Si des associations se sont pourtant jointes à la campagne (voir article : « les acteurs de la contestation) et ont bien apporté du soutien matériel, technique ou juridique, leur implication semble toutefois limitée. Aucune preuve n’est encore apparue qui établisse que des mouvements contestataires reçoivent des financements de groupes politiques ou partisans pour leur campagne.
L’essentiel de l’organisation des manifestations et rassemblements s’effectue par des appels aux dons postés sur les réseaux sociaux. Il s’agit de recours à des plateformes de financement participatif, comme le réseau international OPEN, et dont les fonds recueillis servent à la location d’autocars, de matériel de sonorisation ou d’hébergement. C’est une pratique de plus en plus répandue, qui permet une mobilisation horizontale, indépendante des grandes organisations politiques.
La contestation virtuelle
La nébuleuse des mouvements contestataires s’est principalement structurée sur les réseaux sociaux, qui sont devenus un lieu de communication essentiel, et dont l’impact avait déjà pu être constaté dans des mouvements de contestation dans d’autres pays. On se souvient notamment des débuts du « Printemps arabe », où l’on avait assisté, principalement en Egypte, à une première expression de la jeunesse, avant que le mouvement ne soit récupéré par les islamistes. En France, le mouvement des Gilets Jaunes a également trouvé dans les réseaux sociaux un média très efficace en termes de mobilisation et de diffusion de ses revendications, hors des canaux traditionnels des médias professionnels et des acteurs politiques.
Les réseaux sociaux servent aussi au partage des tâches. Les appels à la manifestation sont d’abord diffusés sur Facebook, avant d’être relayés par d’autres supports. L’organisation logistique s’effectue également sur la plateforme, via des propositions de covoiturage ou de location de véhicules ou de matériel de sonorisation. Les consignes et les instructions sont aussi coordonnées sur les réseaux sociaux, notamment pour les numéros d’urgence à connaitre en cas d’arrestation ou l’envoi de petits groupes à proximité des postes de police pour identifier les personnes interpellées. Les mouvements de contestation tiennent à maitriser leur récit des événements et encouragent leurs sympathisants à poster sur les réseaux les images et vidéos des manifestations.
Faute de siège physique pour leurs activités, les mouvements de contestation utilisent encore les réseaux sociaux comme une agora virtuelle en y organisant des conférences et des débats diffusés par vidéo.
Le spectre de la « récupération »
Ce sentiment d’indépendance est toutefois contrebalancé par la crainte permanente d’être dilué ou récupéré par des structures plus puissantes et en particulier les partis politiques. « Aveuglés au sommet » (Sanverim Batsameret), un essai publié en 1975 par le journaliste Shimshon Ofer est en passe de devenir la bible des contestataires de 2020, qui postent sur Facebook les bonnes feuilles du livre depuis longtemps introuvable. Le correspondant militaire du journal Davar y dénonçait la façon dont les responsables politiques avaient manipulé le public israélien durant les années qui avaient précédé la guerre de Kippour. Aujourd’hui le mécanisme décrit par Ofer est repris pour expliquer comment les leaders de la contestation sociale de 2011 ont été neutralisés en rejoignant la politique. Stav Shaffir ou Itzik Shmuli qui étaient alors les chefs de file du mouvement, ont ensuite adhéré au parti Travailliste et sont entrés à la Knesset. Itzik Shmuli est aujourd’hui ministre des Affaires sociales du gouvernement Netanyahou.
Les activistes de la contestation Balfour y voient la façon dont l’appareil politique israélien a toujours fonctionné pour désactiver l’expression extraparlementaire, en déconnectant les chefs de file de leur base. Et c’est ce qui les renforce dans leur détermination à refuser le dialogue avec les partis politiques, du moins ceux de la majorité. Tant qu’aucun interlocuteur ne se distingue plus qu’un autre, ni n’apparait comme leader du mouvement, il sera impossible de le faire taire, puisque précisément, le mouvement n’a pas de tête.
Reste que cette absence de leadership porte aussi ses limites. Elle évite les scissions mais aussi la cohésion, et entraine à terme, soit un essoufflement, soit une mutation. D’autres contestations populaires dans d’autres pays ont débouché sur l’émergence de nouvelles forces politiques ou sur une prise de contrôle par des forces préexistantes. S’il est trop tôt pour dire comment évoluera la contestation Balfour, une chose est certaine : l’expression populaire, comme la nature, a horreur du vide.