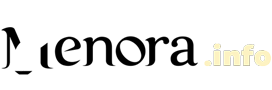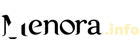Doctorante en travail social à l’Université Hébraïque de Jérusalem, Shelly Engdau-Vanda, elle-même immigrante d’Ethiopie, a publié en 2019 « H’ossen Be’aguira » (la force dans l’émigration), une enquête auprès de vingt Israéliens d’origine éthiopienne, qui racontent leur odyssée vers Israël et leur intégration. Elle en tire des constats difficiles, mais aussi de l’espoir.
Propos recueillis par Pascale Zonszain
Menora.info : Quels sont les principaux changements qu’a subis la communauté éthiopienne depuis l’alyah des années 80 ?
Shelly Engdau-Vanda : Ils sont nombreux ! On peut dire que la communauté a changé de manière très rapide. En l’espace d’une génération et demie, ce sont de véritables bouleversements qui se sont produits à tous les niveaux. La communauté est devenue moins traditionaliste et plus laïque, sa structure collective est devenue plus individualiste, elle est aussi moins éthiopienne et plus israélienne. Le passage culturel et linguistique qui a suivi le passage physique d’un pays du tiers monde à un pays moderne, s’est réalisé très rapidement y compris dans la vie de tous les jours. Cela a évidemment des aspects positifs et d’autres qui le sont moins. Les adultes comme les plus jeunes changent très vite et s’adaptent à l’environnement.
Comment ces plus jeunes, de la génération née en Ethiopie et qui a grandi en Israël s’est-elle adaptée ?
Elle s’est adaptée totalement. Elle a une capacité d’évolution et d’intégration remarquable.
C’est-à-dire que ces jeunes de la « génération un et demi » se définissent d’abord comme Israéliens ?
Chacun se définit à sa manière. Mais concrètement, ils ont intégré la langue, la culture, les « rites » israéliens, que ce soit dans l’apparence extérieure, l’habillement, la religion. Quant à la deuxième génération, née en Israël, elle est totalement israélienne. Les plus âgés ont d’ailleurs eux aussi évolué, même s’ils conservent encore certaines composantes de leur culture traditionnelle, dans les vêtements ou les pratiques religieuses. C’est une population très diversifiée, hétérogène.
La communauté continue-t-elle à habiter les « quartiers éthiopiens » ou commence-t-elle à s’intégrer dans les autres quartiers ?
Il y a une tendance à sortir des quartiers. Mais le lieu de résidence est encore très marqué par la politique d’intégration du gouvernement, qui n’a pas vraiment fait confiance aux olim d’Ethiopie et qui a été directif dans le choix de l’habitat. Parce qu’ils arrivaient sans ressource, il était facile de leur dire où aller, sans leur donner beaucoup d’options. On a fait entrer les immigrants éthiopiens dans des parcours imposés, que ce soit pour le logement ou pour la conversion. Depuis les années 90, ce sont peu ou prou les mêmes quartiers qui abritent l’essentiel de la population éthiopienne, les plus âgés mais aussi les jeunes. Si certains ont quitté ces quartiers quand ils se sont rendu compte que l’environnement n’était pas bon pour eux, tous n’en ont pas les moyens financiers. Et il y a aussi le phénomène inverse de jeunes qui retournent chez leurs parents ou près de leurs parents, là encore pour des raisons économiques. Et ces quartiers qui datent des années 50 ont déjà connu d’autres cycles d’alyah et leurs infrastructures sont souvent en très mauvais état. Ce sont des quartiers difficiles, tant sur le plan de la pauvreté que de la criminalité. C’est une sorte d’incubateur dangereux pour jeunes en difficulté. Ce n’est pas parce que les olim d’Ethiopie ne sont pas des gens bien. C’est parce que des gens bien viennent dans de mauvais quartiers. Quant aux projets de réhabilitation, ils tiennent plus jusqu’à présent de modifications cosmétiques, que d’un traitement en profondeur.
On a assisté ces derniers mois à de nouvelles manifestations de la communauté, suite à la mort du jeune Solomon Teka, tué accidentellement l’été dernier par un policier. Que dit cette colère de l’état de la communauté éthiopienne ?
Elle exprime une profonde exaspération. Cette affaire n’a pas surgi de nulle part. Elle est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Il y a de nombreux cas de brutalité policière dans les quartiers. Il y a une véritable violence qui vise les enfants et les adolescents. Le nombre d’ouvertures de procédures pénales contre les jeunes Ethiopiens en témoigne. On fait de ces jeunes des punchingballs. Beaucoup ont été blessés. Quand il y a des manifestations, cela fait les gros titres, mais il y a énormément de cas qui n’arrivent jamais jusqu’aux médias. L’affaire Solomon Teka s’est produite sur une accumulation qui avait débuté bien avant. Pourtant, les médias se sont rangés du côté du policier et le public israélien aussi.
Pourquoi, selon vous ?
Il y a une défiance de l’opinion à l’égard de la communauté éthiopienne. S’il y a eu un temps où l’on pensait que les Ethiopiens étaient des gens « très gentils », simples et ignorants, ces stéréotypes n’ont pas tenu. Parce que les Ethiopiens eux-mêmes ne sont plus prêts à se taire. Cela fait quarante ans qu’ils se battent pour gagner leur place. Les mouvements de contestation ne cessent pas, chez les jeunes comme chez les plus âgés. Et les jeunes se battent pour leur vie. On n’en est plus à l’époque où les olim d’Ethiopie se battaient contre la conversion imposée ou pour faire venir leur famille d’Ethiopie. Aujourd’hui c’est pour leur vie qu’ils protestent. Il y a au moins une dizaine de cas pour lesquels on sait que des jeunes sont morts à cause de violences policières. Seulement, il n’y a pas de témoignage. Alors quand cette exaspération s’exprime par des manifestations, le public ne voit qu’une communauté violente, sans chercher plus loin. C’est nous ou eux et l’antagonisme se réduit à la couleur de la peau. Il y a beaucoup de haine dans la société israélienne qui s’exprime contre différentes populations. Et particulièrement contre les Noirs. Alors quand on voit un policier blanc face à un jeune éthiopien, tout le monde prend parti pour le policier blanc. Ce serait différent si le jeune était d’une autre origine. Regardez aussi ce qui se passe avec Avera Mengistu [ce jeune Ethiopien souffrant de troubles psychologiques qui est entré dans la Bande de Gaza en septembre 2014 et dont on est sans nouvelle depuis, NDLR]. Les Israéliens ne se sont pas mobilisés pour lui, comme ils l’ont fait pour Naama Issachar, cette jeune touriste arrêtée en Russie pour détention de haschich et qui a été libérée il y a quelques semaines. Personne d’autre ne se bat pour Avera.
Quelle doit être la réponse à donner aux manifestations de racisme et de violence policière ?
Il faut commencer par examiner réellement tous les cas qui se produisent. Il faut que des procédures soient engagées, que la police sanctionne ceux dans ses rangs qui se sont rendus coupables de brutalités. La police en tant qu’institution ne fonctionne pas comme elle devrait le faire. Les procédures quand il y en a, sont expédiées, les dossiers classés sans suite. Cela légitime la poursuite de ces dérives, au lieu de les disqualifier. Et cela creuse la défiance envers les institutions.
Et pourtant, vous parlez aussi dans votre ouvrage de la force et de la résilience des olim d’Ethiopie. Qu’est-ce qui leur donne ces capacités ?
Cela commence par l’éducation. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent par leur famille les valeurs de respect envers les ainés, de l’aide à son prochain, de la solidarité, de la compassion, de la générosité. Ils partent alors dans la vie avec une sorte de force d’âme. Les enfants prennent très tôt le sens des responsabilités et de l’indépendance. Beaucoup de jeunes ont aidé leurs parents à s’intégrer, ils ont été le pilier sur lequel leurs ainés ont pu s’appuyer.
Et cela perdure ?
Cela perdure et toujours aussi fort. Et c’est ce qui donne à ces jeunes la capacité de réussir, de se réaliser. On voit d’ailleurs beaucoup de cas de réussites individuelles chez les jeunes de la « génération un et demi ». Moins en revanche de réussites collectives. Il n’y a pas encore de percée au niveau de la communauté, mais de plus en plus de jeunes font des études, avancent professionnellement, s’intègrent dans la société israélienne.
Ces jeunes qui réussissent servent de modèle aux autres ?
Oui, mais pas seulement à l’intérieur de la communauté. En réussissant, ils changent le regard de la société sur eux. Par leur niveau d’engagement et d’exigence, ils font peu à peu évoluer les choses. Mais pour s’élever, ils doivent travailler mille fois plus dur que les autres et se battre bec et ongles. Les plus forts y parviennent. Pour les autres, c’est évidemment plus difficile.